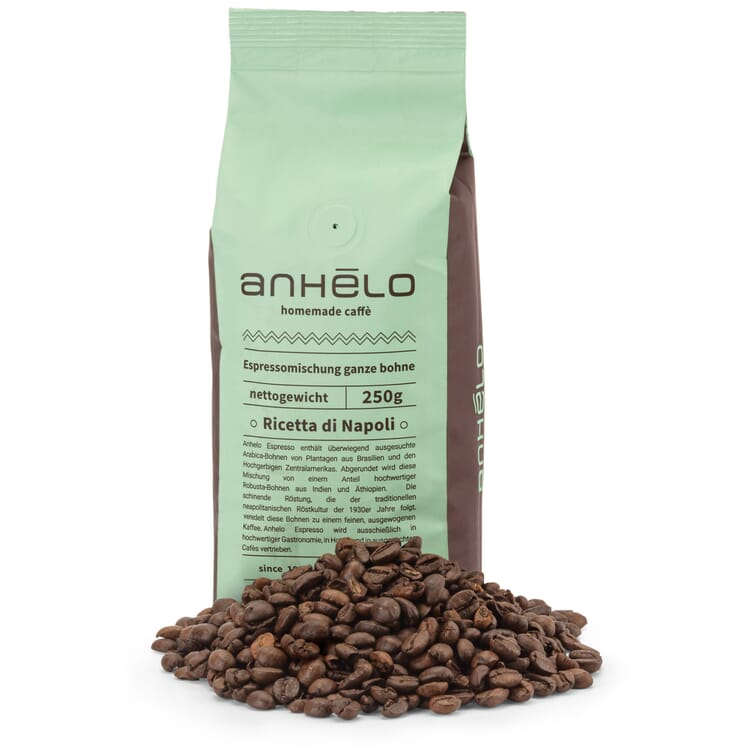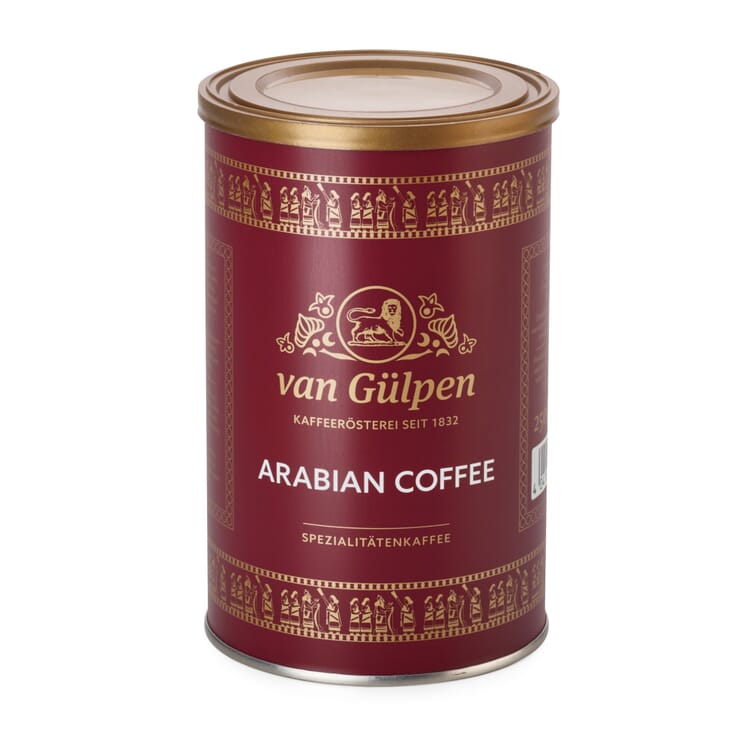La culture des cafés viennois. Une tradition accentuée
Les Viennois n'ont pas été les premiers à boire du café, et leurs cafés n'ont jamais été les seuls. Pourtant, aucune ville au monde n'a été et n'est encore aussi liée au mot café que la capitale autrichienne. En 2001, la culture des cafés viennois a même été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Dans le cadre de l'ouverture de notre premier grand magasin autrichien à Vienne, nous jetons un coup d'œil sur les choses qui font du café viennois une véritable institution reconnaissable entre toutes et un must pour tout touriste à Vienne.
L'établissement
Un café viennois traditionnel se caractérise (du moins depuis le XIXe siècle, avant cela, il s'agissait plutôt de lieux sombres et sans charme) par une série de traits récurrents, qui ne sont pas forcément tous exacts, mais dont la plupart sont très caractéristiques. Il y a d'une part les petites tables en marbre, rondes ou carrées, puis les chaises en bois courbé, également connues sous le nom de chaises de café, et souvent en complément : des loges en peluche ou au moins rembourrées, de petits compartiments avec un soupçon d'intimité. La table à journaux est également essentielle, sur laquelle des périodiques nationaux et internationaux sont exposés dans des porte-journaux en bois - des tables de billard, des jeux d'échecs ou de cartes complètent dans certains établissements l'offre de divertissement. Les grands miroirs aux murs, les porte-manteaux en bois courbé et les lustres parfois somptueux sont également très répandus. Ceux qui en ont la possibilité proposent également des places assises à l'extérieur, même s'il ne s'agit que de trois petites tables : "Schanigarten" est le nom de cette forme spécifiquement autrichienne de restauration en plein air.
Les spécialités de café
Si l'on se rend aujourd'hui dans un café viennois, ce n'est pas seulement pour s'imprégner de l'atmosphère traditionnelle et historique, mais aussi et surtout pour savourer l'une des nombreuses spécialités de café qui permettent aux Viennois de se démarquer de la monotonie internationale du café.
Alors qu'il existe aujourd'hui d'innombrables variations aux noms parfois créatifs, il semble qu'au début, on commandait encore à l'aide d'une palette de couleurs allant du noir au blanc laiteux. Chaque café (qui, à Vienne, doit absolument être accentué sur la deuxième syllabe) est servi avec un verre d'eau sur un plateau argenté et se distingue de l'autre par l'ajout ou l'omission de crème (fouettée), de lait (mousse), de sucre et de spiritueux dans une certaine quantité et dans un certain ordre de stratification.
Le service se fait au choix dans des bols (chez nous : tasses) ou des verres (à anse) de différentes tailles. La base de presque toutes ces spécialités est d'ailleurs un moka viennois, un petit café noir qui, à l'origine, sortait souvent d'une cafetière à piston. Mais aujourd'hui, la culture de l'espresso s'est également installée depuis longtemps à Vienne et la fabrication d'un moka correspond souvent en grande partie à son équivalent italien. Selon la personne à qui l'on demande, le moka est toutefois préparé avec un peu plus d'eau, infuse un peu plus longtemps et est en outre traditionnellement préparé avec des grains plus fortement torréfiés de la variété de moka. Il serait trop long d'énumérer toutes les spécialités, mais voici quelques-unes des plus courantes et des plus créatives, avec leur composition habituelle :
- petit et grand noir : moka simple ou double.
- allongé (noir) : Moka infusé avec de l'eau chaude.
- Petit et grand Brauner : Moka simple ou double, servi avec de la crème ou du lait dans un pot séparé, minuscule. Les proportions du mélange sont laissées à l'appréciation du client.
- Capucin : moka simple servi avec quelques gouttes de crème liquide et parfois couronné de crème fouettée. Sa couleur est censée rappeler celle de la robe d'un moine capucin.
- Moka à un seul cheval : moka (allongé) avec une généreuse couche de crème fouettée (le "gupf"), servi dans un verre à anse. Il pouvait ainsi être consommé d'une seule main par le cocher des voitures hippomobiles et restait chaud longtemps grâce à l'épaisse couche de crème.
- Mélange viennois : café ou moka allongé, servi avec la même quantité de lait très légèrement mousseux dans un bol.
- café à l'envers : un tiers de moka, un tiers de lait et un tiers de mousse de lait, servis dans un verre - comparable au latte macchiato. 8. franciscain : un mélange, avec une mousse de lait au lieu d'une mousse de chantilly, servi dans un bol.
- fiaker : double moka servi dans un verre avec beaucoup de sucre et 1-2 cl de sliwowitz ou de rhum, surmonté de crème fouettée. 10. kaisermelange : moka servi avec un jaune d'œuf battu, du miel (ou du sucre) et du cognac, parfois avec de l'Obers.
- Neumann précipité : crème fouettée "précipitée" dans un bol avec un double moka. 12. Maria Theresia : moka à la liqueur d'orange, servi avec de la crème fouettée dans un verre à anse.
L'histoire
La légende selon laquelle le premier café viennois aurait été fondé par Georg Franz Kolschitzky, un interprète et homme d'affaires polonais qui, pendant le siège turc, s'est faufilé derrière les lignes ennemies, a obtenu des informations et a été récompensé par des grains de café, est encore très vivace aujourd'hui. Une belle histoire, mais qui n'est malheureusement qu'à moitié vraie. Kolschitzky était certes un éclaireur, mais jamais un cafetier. Le premier café local a plutôt été fondé par le commerçant arménien (et futur espion) Johannes Diodato, qui a obtenu en 1685 de la cour de Vienne, pour deux décennies, ce que l'on appelle la "liberté de la cour", c'est-à-dire quasiment une autorisation de débit de boissons délivrée en haut lieu. Les Viennois se sont rapidement révélés être de véritables fans de café - le nombre de cafés a d'abord augmenté lentement, mais bientôt de plus en plus rapidement. Cent ans plus tard, on en comptait 70, 40 ans plus tard 150 et vers 1900, on dénombrait 600 de ces établissements qui s'étaient déjà établis au 19e siècle comme les lieux culturels par excellence de la métropole autrichienne et qui, au tournant du siècle, connurent leur apogée en tant que cafés littéraires.
Les invités
Ce n'est pas seulement le café qui a fait la réputation des cafés viennois. C'est aussi et surtout le public qui s'est approprié les cafés comme second foyer et en a fait un lieu de communication, d'échange et de travail - surtout depuis le milieu du 19e siècle. Qu'il s'agisse de sujets privés, politiques, commerciaux ou culturels, ils étaient tous traités ici. Des artistes comme des musiciens, des hommes de lettres, des architectes et des acteurs, mais aussi des scientifiques, des juristes et des hommes politiques - chaque groupe avait son lieu de prédilection. Certains habitués, notamment Peter Altenberg, à qui le Café Central a même rendu hommage, poussaient le vice jusqu'à indiquer "leur" café comme adresse postale, à y être joignables par téléphone et à y recevoir des invités. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les cafés n'étaient fréquentés que par des hommes. Ce n'est qu'à partir de 1856 que les femmes ont été autorisées à entrer - elles se sont d'abord limitées à jouer les accompagnatrices, puis elles ont eu pendant un certain temps leurs propres salons séparés. Les clients n'avaient d'ailleurs pas besoin de s'endetter pour leurs longs séjours : en commandant un seul café, ils achetaient déjà le droit de rester aussi longtemps qu'ils le souhaitaient.
Le personnel
Le personnel constitue un élément essentiel de l'atmosphère du café. D'une part, il y a le serveur (maître d'hôtel) qui veut absolument qu'on l'appelle "maître d'hôtel" et qui porte traditionnellement un smoking. Autrefois, il était encore secondé par le piccolo, un (jeune) serveur auxiliaire chargé d'installer les tables et les chaises et de verser de l'eau aux clients. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la seule dame dans le café était la caissière assise, assise derrière la caisse ou le buffet souvent vitré, et qui ne se contentait pas de distribuer du sucre et bien sûr d'encaisser, mais qui servait aussi d'objet de flirt aux clients.